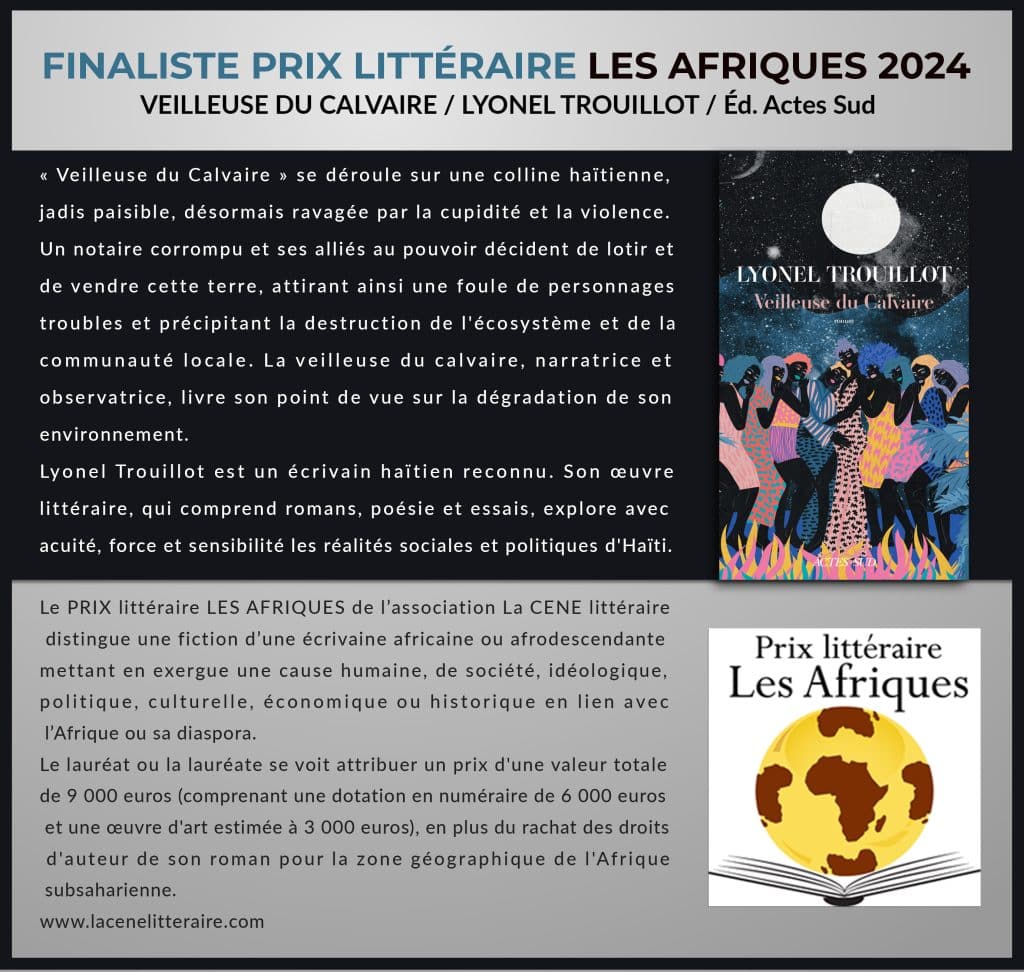Editions Actes Sud, 2023
oète et romancier, né en 1956 dans une famille de lettrés, Lyonel Trouillot s’affirme de livre en livre comme une des figures majeures de la littérature haïtienne en français, en particulier après la disparition ce 20 février de l’écrivain Franketienne (1936-2025). Son œuvre s’inscrit dans les parages du spiralisme, dont ce dernier a été un des initiateurs et promoteurs avec René Philotecte (1932-1995) lequel avait en 1989 préfacé son premier roman (Les Fous de Saint-Antoine) : il est de ce point de vue significatif qu’à titre posthume Trouillot lui ait rendu la pareille, en 2003, en introduisant à son anthologie Poèmes des îles qui marchent et que cette année il ait salué sa mémoire à l’occasion du trentième anniversaire de sa mort. Dans l’hommage rendu ce 6 février à un aîné dont l’influence a été considérable, Trouillot n’hésite pas à avancer que « Haïti souffre aujourd’hui d’un déficit de voix fortes portant, dans la douleur et la catastrophe une critique radicale du présent et un chant d’espérance ». Cette remarque fournit à bien des égards une grille de lecture et d’interprétation afin de mieux cerner l’originalité et les qualités de son roman Veilleuse du calvaire (depuis sa parution en août 2023, Trouillot a publié un recueil de textes courts, Histoires simples, et un roman Antoine des Gommiers), ouvrage qu’il a conçu « en dialogue » et en résonance avec le réalisme merveilleux cultivé par un Jacques Stephen Alexis (en écho avec le real maravilloso d’Alejo Carpentier) désireux d’articuler vision sociale et culture populaire.
Force en effet est de constater qu’au lendemain de la chute du dictateur Jean-Claude Duvalier, dit Bébé Doc, qui avait succédé à son père (le tyran François Duvalier), la tonalité de la production romanesque de Haïti s’est nettement infléchie et est devenue de plus en plus sombre, comme si l’obscurcissement de l’horizon social et politique rejaillissait directement sur les représentations et les univers littéraires. Ainsi que la chercheuse et critique François Cévaër l’a relevé, ce processus a été enclenché dès les années 1960, au fur et à mesure que s’estompait la perspective d’un monde moins âpre : les héros prométhéens (comme ceux que l’on trouve dans Gouverneurs de la rosée de Jacques Roumain en 1944 et dans Compère Général Soleil de Jacques Stephen Alexis en 1955), cèdent la place à des personnages davantage « problématiques » ; ils sont remplacés par des « dégradés » et des « faillis » (Trouillot fait paraître Parabole du failli en 2013), des quasi « zombies ». L’universitaire Rafaël Lucas a pointé comment le motif de ce vivant réduit à l’état végétatif (René Depestre) – un presque mort ou un mort-vivant – renvoie à la fois à un peuple anéanti par la domination et les exactions, et à des individus au bord de « l’effondrement ontologique ». C’est dans ce contexte qu’il convient de situer Veilleuse du calvaire, dans et pour lequel Trouillot mobilise la fable et le merveilleux afin d’élucider pourquoi la colline du Calvaire, microcosme de la société haïtienne, a sombré dans le marasme : « dès le début : la prédation et le pillage ».
Le site, qu’affecte « [l’]odeur forte du passé », a été dévasté, depuis que les Mérable ont jeté leur dévolu sur lui. Marcello, le notaire, « grand-père de l’actuel propriétaire », se l’est approprié, « il y a près de cent ans ». Il l’a d’abord arpenté avec ses amis et relations, une poignée de notables, comme un terrain de chasse ; ensuite, en le vouant à la spéculation foncière, il a créé les conditions d’en faire une villégiature pour le « gratin » de la ville. L’évolution économique et sociale du pays l’a transformé en zone d’habitat précaire pour les populations en proie à l’exode rural.
Désormais la hautaine bâtisse des Mérable n’est plus qu’un « immeuble décrépit, seul héritage de la richesse d’autrefois ». Y résident le dernier de la lignée, « pingre et taciturne », et de surcroît voyeur, un « un vieil homme qui sent le moisi et la guigne dans son costume trois-pièces blasé et mille fois recousu » ; les « deux Alarik », le père (un ancien milicien ayant du sang sur les mains et des crimes sur la conscience) et son fils (un peintre raté profitant de la naïveté et de la solitude des « désœuvrées ») ; le méprisable Fritz et Marlène, sa souffre-douleur, dont celui-ci abuse et qu’il violente, les soirs quand il a bu « avec ses copains » ; et une étudiante de vingt-trois ans « qui écrit son premier roman », consignant la geste « [d]es femmes qui ont vécu ici et qui refusent qu’on les oublie » car « toute la violence du monde s’est abattue ici sur [leurs] corps ».
Un épouvantable « secret » lie l’héritier et le macoute : le martyr d’une « jeune fille », d’une « vierge » enlevée, torturée et enterrée sous « la grande salle » de cette demeure. Elle a été sacrifiée par un Alarik qui croyait obtenir une « promotion » en commettant cette monstruosité et un Mérable qui par cet acte immonde s’imaginait être en mesure de « redonne[r] du lustre à la villa ». Très adroitement, Trouillot confie le récit de cette ignominie au personnage de la jeune romancière qui, ainsi, se pose en veilleuse du calvaire de la victime.
Trouillot a rédigé son texte dans une langue somptueuse (« Mon style, c’est la douleur arrachée au silence ») et il l’a intelligemment agencé et composé, tressant « deux manières de raconter », en l’occurrence une « reconstitution par qui rapporte des événements qu’il n’a pas lui-même vécus » et la « parole de qui a vu, vécu, senti, souffert ». Il s’ensuit que la narration est continûment hantée par le poème si bien que, malgré la désolation décrite et dénoncée, un chant s’élève et se déploie comme un « feu de joie qui brûle sous les ruines ». Du fait de ce dispositif, l’ouvrage tranche considérablement avec la tendance qui, selon l’écrivain, en ce moment sévit en Haïti de ne concevoir que « des histoires d’adultère et d’intrigues familiales sur le modèle des télénovelas ».